Biogénétique : Au-delà de la grossière supercherie de la secte des raéliens – Clonage humain, les vrais enjeux
16 janvier 2003, extrait de l’article du Figaro
[…] Si une quasi-unanimité se manifeste ainsi contre le clonage reproductif chez l’homme, une intense discussion, en revanche, se développe autour du clonage dit thérapeutique. Les fantasmagories, dignes du docteur Moreau, qui annonçaient il y a quelques années l’élevage clandestin d’individus clonés destinés à être dépecés au cours de leur vie pour fournir, en pièces détachées, des organes à leurs “jumeaux”, ne font apparemment plus guère recette.
Chacun devrait savoir qu’il ne s’agit en fait que de cultiver en laboratoire des cellules et des tissus en cas de nécessité. Le débat est particulièrement vif parce que ce type de recherches ouvre la voie à l’étude des cellules souches qui permettra à terme de mieux connaître des pathologies comme le cancer, de traiter les grandes maladies dégénératives du système nerveux (Alzheimer, Parkinson…) et de révolutionner l’art de la greffe humaine en la libérant de l’hypothèque des phénomènes de rejet comme de celle du manque de donneurs, même dans les pays où la notion de “mort cérébrale” a été admise.
Trois types d’arguments sont avancés en faveur de l’interdiction. La technique, dit-on, étant finalement la même, une “pente glissante” exposerait les chercheurs à la tentation de passer du clonage thérapeutique au clonage reproductif, avec toutes les horreurs qui s’y attachent, dès lors qu’ils auraient pris le pli de fabriquer des cellules embryonnaires. Le débat est ouvert. Il pourra prendre une tournure très technique.
Deuxième argument : la technique conduit à détruire des cellules embryonnaires à différents stades de développement, or tout embryon n’est-il pas une “personne potentielle” ? Ce n’est pas d’aujourd’hui que la discussion fait rage sur la question de la date à laquelle il peut être considéré comme tel.
Un troisième type d’arguments de portée plus générale vient d’être introduit dans le débat par des philosophes : c’est en réalité, disent-ils, la technique du clonage elle-même, dès lors qu’elle s’applique à l’homme, qui est en cause, car elle vient bousculer notre représentation de la condition humaine. Ce que nous appelions la “nature humaine” se trouve mis en question, comme l’ont fort bien vu aussi bien ceux qui annoncent pour demain l’ère de la “posthumanité”, comme Francis Fukuyama, que ceux qui, en un sens différent, s’interrogent opportunément avec Jürgen Habermas sur “l’avenir de la nature humaine”.
Allons-nous prendre peur et nous replier, sous la bannière de l’éthique, sur la défense de thèses philosophiques établies et de dogmes théologiques institués, sans plus de discussion ? Si nous voulons nous montrer à la hauteur de ce qui nous arrive, nous n’échapperons pas à la nécessité de faire preuve d’invention normative, c’est-à-dire au premier chef juridique, éthique et politique. Et, si nous voulons que cette inventivité s’exerce au bénéfice de tous, il nous faudra intégrer les leçons de la science et des technologies dans le travail d’une pensée philosophique s’employant à méditer dans le sens du progrès pour l’homme les exigences normatives de la vie humaine dans leur diversité. […]










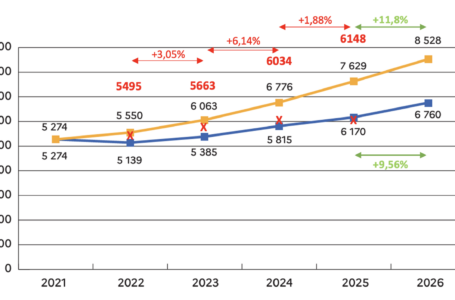

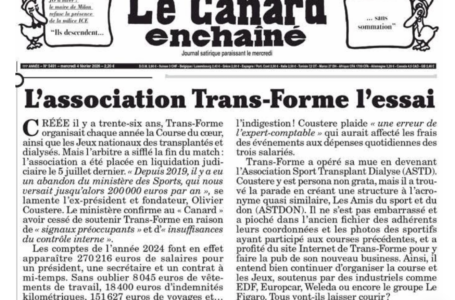


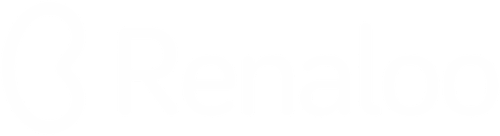




 Followers
Followers