Derrière le corps, la personne
25 septembre 2003, Le Quotidien du Médecin
Dans le don d’organes post mortem, c’est la famille qui est le plus souvent sollicitée, ce qui la renvoie à sa propre représentation de la mort et du corps. La mort cérébrale est encore, dans l’opinion, empreinte d’une forte ambivalence.
« Devant un corps un peu animé, doué de quelques mouvements et toujours un peu chaud, les gens ont tendance à considérer que la personne n’est pas totalement morte. Le prélèvement leur apparaît comme quelque chose contre nature », explique Claire Boileau, ethnologue rattachée au laboratoire Sociétés Santé Développement (université Bordeaux-II). De plus, le prélèvement conduit à une fragmentation et à un éparpillement des corps qui vient heurter notre conception même de l’homme : « Le corps, dans cette perspective, n’est plus tout à fait le visage de l’identité humaine, mais une collection d’organes, un avoir, une sorte de véhicule dont se sert l’individu et dont les pièces sont interchangeables avec d’autres de même nature, moyennant une condition de biocompatibilité entre tissus. L’homme est promu locataire de son propre corps », dit David Le Breton dans « la Chair à vif ». C’est la vision d’un corps « machine » qui est là désignée. Finalement, « on s’aperçoit que derrière le corps, il y a toujours la personne. Et derrière le refus, il y a la volonté de respecter la dignité et l’intégrité d’un proche ».
Cependant, le donneur donne sans contrepartie. Par solidarité et générosité, il met son corps à la disposition de tous les malades. En vertu du principe du consentement présumé, son silence tend à être interprété de manière positive. Dès lors, son corps appartient à la société qui en use selon les règles qu’elle s’est fixées. Jusqu’où peut-elle le solliciter ? Les plus fortes oppositions portent sur les organes les plus visibles : cornées et peau, symboliquement très investis (« ils veulent sa peau ») ou sur le cœur, qui était considéré comme l’organe noble avant d’être détrôné par le cerveau. Or, à propos de ce dernier, Jean Bernard prophétise : « Voici que depuis plusieurs années, dans le traitement de certaines maladies nerveuses, la greffe de quelques centaines de cellules nerveuses venant d’une personne saine est envisagée. De quelques centaines, on passera à quelques milliers. D’un territoire minime à un territoire plus étendu. Les limites de cette extension éventuelle ne peuvent être fixées actuellement.»
Dr Lydia ARCHIMÈDE










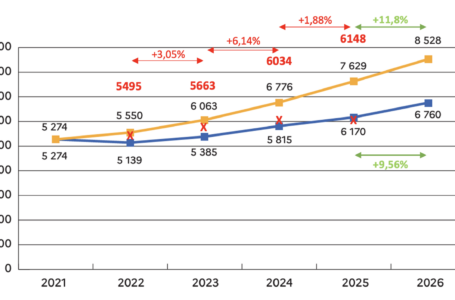

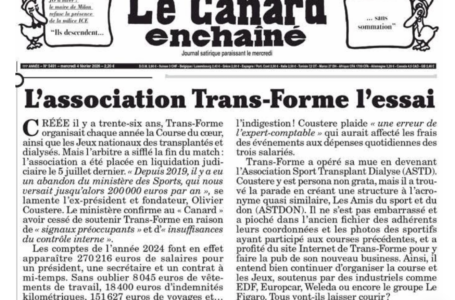


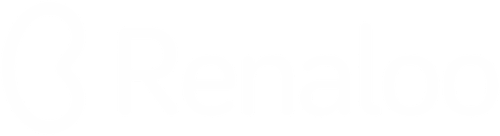




 Followers
Followers