La commercialisation du corps, un phénomène irréversible
16 novembre 2004, Le Figaro
Un entretien avec le président du Comité consultatif national d’éthique
Lors des Journées annuelles d’éthique qui s’ouvrent aujourd’hui à Paris, les membres du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) vont aborder plusieurs nouveaux champs de réflexion dont celui des nouvelles technologies de la reproduction et la commercialisation du corps. Le professeur Didier Sicard, président du comité, fait le point.
Propos recueillis par Catherine Petitnicolas
Le FIGARO. – Des étudiantes américaines vendent aujourd’hui leurs ovocytes à prix d’or, lorsqu’elles sont belles et issues d’universités prestigieuses, pour permettre à des femmes stériles d’avoir des enfants. Que pensez-vous d’un tel phénomène ?
Professeur Didier SICARD. – La commercialisation du corps humain me semble être un phénomène de société irréversible. Nous sommes en train de passer du corps-personne au corps-machine. Culturellement, on est arrivé à un stade où l’on donne aux individus le sentiment qu’ils ne sont qu’un amas de pièces détachées indéfiniment remplaçables – rein, foie, coeur, poumons, peau, ovocytes voire tissus foetaux. Et donc que tout est réparable et commercialisable.
Et l’éthique dans tout cela ?
La France est leader en ce domaine, mais elle est très minoritaire. Elle est presque le seul pays au monde à revendiquer deux principes, l’indisponibilité et l’inviolabilité du corps. Un individu ne peut pas décider de son propre chef qu’il va donner son rein. Il ne peut le faire que dans le cadre de la loi et uniquement à des personnes très proches – ascendants ou descendants, frères ou soeurs, conjoint ou concubin – et, tout récemment, cette possibilité a été élargie aux cousins de premier degré. Le but étant de tout faire pour éviter une commercialisation cachée et une contrainte sur le donneur. Même si, dans une situation familiale donnée, je pense qu’il y a plus de contraintes exercées sur le donneur qu’on ne le croit. Comment un frère, par exemple, peut-il résister à la proposition médicale de donner un rein à son frère en attente de greffe ?
Le paradigme en France de la non-commercialisation, c’est le don du sang. Depuis soixante ans, c’est même un des fondements éthiques de la médecine et de la société. On imagine mal un retour à la vente du sang. Mais cette vision française du don bénévole, anonyme, est extraordinairement isolée en Europe. En Allemagne, en Suisse, en Autriche, on est payé pour cela. Pas grand-chose, certes, de l’ordre de 15 à 20 euros, et bien souvent les gens redonnent cette somme à des oeuvres.
Ne vaut-il pas mieux qu’il n’y ait aucun lien d’argent entre donneur et receveur ?
Oui et non. Effectivement, cela protège des tentations. Mais cela permet aussi toutes les transgressions souterraines. Pour revenir aux greffes d’organes, on sait très bien qu’un grand nombre de Français vont se faire transplanter un rein en Inde ou au Moyen-Orient. En France, la loi est certes très autoritaire, mais il existe une très grande permissivité. Contrairement à la Grande-Bretagne. Les Anglais sont permissifs au niveau de la loi mais très rigoureux au niveau de ses applications individuelles.
Les membres du comité d’éthique se penchent sur ce sujet. Je ne sais pas encore quelles vont être leurs conclusions. Mais la tentation serait peut-être d’indemniser le donneur afin d’obtenir une plus grande transparence. Le principe de la commercialisation du corps mérite en tout cas d’être interrogé dans ses conséquences positives et négatives. Car le pire danger, c’est le marché, surtout lorsqu’il a des connotations mafieuses.
Il existe en France une grave pénurie de greffons prélevés sur des personnes en état de mort cérébrale, contrairement à d’autres pays. Que proposez-vous ?
J’avais voulu plaider, lors de la révision de la loi de bioéthique, pour que le consentement au don d’organes soit systématiquement demandé. Par exemple au moment où l’on passe le permis de conduire ou lors de l’établissement de la carte d’identité. Il faudrait que chaque citoyen ait alors la possibilité de donner son agrément ou son refus (1). Sans passer par un tiers ou par la famille. Car, au moment voulu, après un accident par exemple, les proches sont dans une détresse telle qu’ils sont dans l’impossibilité de consentir à un tel prélèvement. En revanche, si cette décision est apposée sur un document officiel, on peut la considérer comme un testament.
[…]
(1) Il existe un registre des refus. Cinquante mille personnes ont fait une telle démarche.










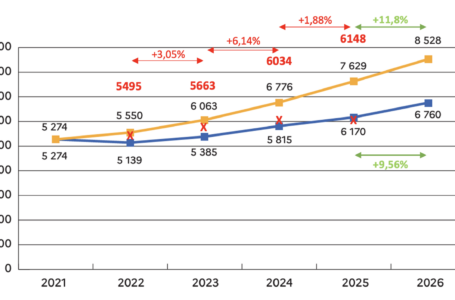









 Followers
Followers