Marie : comment intégrer la maladie chronique dans la construction de soi ?
Maladie chronique et scolarité
Par Marie Astier
La scolarité ce n’est pas seulement une institution (l’école maternelle, primaire, collège, lycée, enseignement supérieure) c’est aussi un moment. Le moment où le petit enfant, l’enfant, l’adolescent et le jeune adulte se construit.
En fait, en y repensant, ma scolarité a été marquée par le fait je ne savais très bien quelle place accorder à ma maladie dans mon identité alors en train de se construire. Et ce pour une raison principale : c’est que ma maladie a pour particularité d’être “invisible” (particularité qu’elle partage avec d’autres maladies chroniques). Je n’ai pas de stigmate physique ou comportemental tels qu’ils permettraient aux gens de deviner que je suis malade.
Nombreux sont les moments de ma vie où j’ai été confronté à la décision de le dire ou de ne pas le dire. Et j’ai souvent choisi la 2ème option pour de mauvaises raisons.
Ce n’est qu’aujourd’hui, au terme de ce parcours scolaire qui est en fait mon parcours de vie (car je ne suis pas bien vieille !) et après avoir réfléchi dessus, que j’assume ma maladie et que j’accepte qu’elle fasse partie de moi puisque, par définition, je n’en guérirai pas mais vivrai toujours avec. Qu’elle fasse partie de moi, c’est-à-dire qu’elle occupe une place dans mon identité mais pas toute la place. Certes je suis malade, mais je ne me résume pas à ma maladie.
Au-delà de toutes les questions un peu techniques d’accessibilité, je pense que ce qui m’aurait véritablement aidée, c’est que l’école m’aide à accepter ma maladie. Mais pour me la faire accepter, il aurait fallu que le système l’accepte aussi. Cela n’a pas toujours été le cas. Mais parfois, dans des situations précises ou grâce à des personnes en particulier, ça l’a été.
Comment faire pour qu’une pathologie invisible ne soit pas source de handicap mais un élément de construction identitaire ?
Je ne prétends pas vous apprendre ce que c’est que la vie avec une maladie chronique. Mais vous faire découvrir concrètement quelle a été une partie de ma vie, à savoir ma scolarité, avec ma maladie chronique, à savoir une maladie rénale et comment cela a influencé la personne que je suis devenue aujourd’hui.
Ma maladie : la cystinose
C’est une maladie génétique “autosomique récessive” : mes parents sont “porteurs sains” c’est à dire qu’un seul de leur gêne (le gêne a été identifié en 1998 : il s’agit du gêne “CTNS” localisé sur le Chromosome 17) est atteint. A la conception j’avais une “chance” sur 4 de développer la maladie.
C’est une maladie très rare, dite orpheline : en France elle touche une centaine de personnes (soit 0,00016 %, soit une personne sur 625 000).
Il s’agit d’un problème de circulation d’un acide aminé, la cystine, qui s’accumule en cristaux dans les cellules de certains organes, surtout au niveau des reins. Le rein est abîmé et ne remplit pas bien sa fonction : filtrer le sang pour garder ce qui est bon pour l’organisme et rejeter le reste. Dans un premier temps, le rein rejette des substances qu’il aurait dû garder. Il faut alors surdoser en amont en sels minéraux pour compenser ces pertes.
Il existe un médicament pour retarder la dégradation des reins, le cystagon, mais dont l’efficacité n’est que de 6 heures : je dois en prendre toutes les 6 heures : 7h30, 13h30, 19h30 et … 01h30.
J’entre difficilement à la crèche … pour finir par sauter la 3e année de maternelle !
Même si ce sont surtout mes parents qui ont été confrontés aux conséquences sociales de ma maladie dans ma petite enfance, il y a un élément qui m’a souvent été raconté, qui fait partie de la “mythologie familiale” : la difficulté qu’il y eu à m’inscrire en crèche.
Les faits : avant que ma maladie ne soit diagnostiquée, mes parents m’ont inscrit dans une crèche à côté de la maison. Mais comme je faisais des otites à répétition, ma pédiatre a considéré que la vie en collectivité ne me convenait pas et a conseillé à mes parents de me faire garder par une nounou (qu’il a été difficile de trouver car il fallait qu’elle accepte de me donner mes médicaments).
Ensuite ma maladie a été diagnostiquée (et on a compris que si je faisais des otites c’est aussi parce que j’étais fragile). Et là la crèche n’a pas voulu me reprendre. C’est seulement grâce à un “contact familial” que j’ai pu aller à une crèche normalement réservé au personnel hospitalier.
Mon analyse :
- La maladie (chronique) peut être source de handicap puisqu’elle peut être source de désocialisation (ou de non socialisation).
- Un enfant, c’est déjà une lourde responsabilité à gérer. Un enfant malade, dont la pathologie est mal connue, encore plus (il faut être particulièrement attentif parce qu’il est difficile de savoir comment la maladie va se manifester, il faut lui donner des médicaments qu’il n’accepte pas facilement de prendre…). Dans les crèches publiques, personne ne voulait me prendre en charge et on ne pouvait pas les y contraindre : contrairement à l’école, la crèche n’est pas obligatoire.
- Alors que je pense qu’il est important d’habituer les enfants, dès leur plus jeune âge, à cohabiter avec des enfants “différents” (quelle que soit la différence). Si elle fait partie de leur quotidien, elle n’est plus perçue comme une différence, ou en tout cas pas comme un problème. Mais comme quelque chose de normal. C’est une des clés de l’intégration (même si ce n’est plus de l’intégration puisqu’ il n’y a alors plus à s’intégrer dans un groupe déjà existant puisqu’on fait partie de ce groupe dès le début)…
La chose dont je me souviens vraiment c’est qu’en maternelle, je faisais des dessins au lieu d’aller en sport.
Les faits : sur les temps d’EPS, moi, je vais voir la psychologue.
Mon analyse :
- La maitresse envisage de me faire sauter la 3e année de maternelle parce qu’elle sent que je m’y ennuie. Le propre d’une malade chronique c’est que, par les contraintes qu’elle implique, elle fait grandir vite. Je n’avais pas la même insouciance que les autres enfants de mon âge.
- Mais en même temps, à cause de cette maladie, on avait peur que je sois trop fragile physiquement pour entrer au CP avec un an d’avance.
- Les tests ont effectivement révélé que j’étais plus mature que les enfants de mon âge, mais que je ne me voyais pas comme une victime potentielle, qui pourrait se faire maltraiter par les autres. Il est apparu que ce n’est pas par ma force mais par le langage que je les “tenais en respect”.
- Sans doute la psy me faisait-elle faire des dessins pour voir quelle image j’avais de moi, d’autant plus que mes parents étaient alors en train de divorcer, ce qui arrive fréquemment quand on découvre que l’enfant est atteint d’une maladie chronique grave.
- Comme je pouvais vraiment avoir le sentiment d’être à l’origine de la rupture de mes parents (peut-être encore plus que dans le cas d’un divorce “normal”), il était d’autant plus important qu’à l’école je sois intégrée dans un/des groupe(s), pour ne pas avoir l’impression que je faisais exploser tous les groupes.
- L’école est très importante pour se construire une image de soi. Et en maternelle elle remplissait apparemment bien ce rôle, puisque je me souviens même que le fait que je n’aille pas en sport ne posait de problème à personne !
- Je pense aujourd’hui que ce succès scolaire a du rassurer mes parents (ce qui n’est pas négligeable comme rôle de l’école) : certes, j’étais malade mais je n’étais pas diminuée (du moins intellectuellement).
Du CP au CE2, je descends tous les jours chez la gardienne prendre mon petit pastis
Mais c’est pour des raisons sérieuses, qui méritent bien un exposé !
Les faits : autant je n’ai pas de souvenir précis de comment je prenais mes médicaments en maternelle, autant j’ai des souvenirs très précis de la façon dont je les prenais en primaire à l’école Pouchet :
- Ma montre sonne en classe
- Je descends chez la concierge (en glissant sur le rampe et en disant “ok chef j’arrive” dans ma montre !)
- Je prends ce que la gardienne appelle “mon petit pastis”
- Je regarde un peu “Les Feux de l’amour” avec elle
- Je remonte en classe
Mon analyse :
- L’appellation “petit pastis” vient du fait que pour me faire avaler mes gélules, mes parents en versaient le contenu dans de l’eau mélangée à du sirop d’anis (un des rares sirops qui ne faisait pas de réactions chimiques avec les poudres des gélules). Ils mettaient la préparation dans des petits pots “amora” et ils en déposaient un tous les matins chez la gardienne (à l’époque ils se gardaient au froid). Appeler ça “mon petit pastis” et m’autoriser à regarder un peu la télé en même temps que je les prenais, c’était une façon de me faire penser à autre chose.
- L’école est une personne morale. La gardienne est une personne physique, qui a accepté de prendre en charge la responsabilité de me donner mes médicaments. Je me souviens bien de cette gardienne portugaise (dont j’ai honte d’avoir oublié le nom aujourd’hui !) avec qui je suis longtemps restée en contact par la suite. Une vraie complicité c’était créé entre nous.
- Aujourd’hui le fait qu’il s’agissait d’une gardienne portugaise ne me semble pas anodin. Du CP au CE2 j’ai été scolarisée à l’école Pouchet, dans le 17e arrondissement, classée Zone d’Education Prioritaire. La “différence” que représentait ma maladie n’en était qu’une parmi d’autres. Entre les arabes, les noirs, les portugais … il y avait tellement de différences qu’il n’y avait plus de “normal” ! Et du coup les dispositifs de prise en charge de ces différences étaient sans doute plus souples qu’ailleurs (je n’allais pas prendre mes médicaments dans une infirmerie, avec qui mes parents auraient signé une décharge ou quelque chose du genre)
Les faits : en CP on doit faire un exposé en classe, sur un sujet de notre choix. Je choisis de parler de ma maladie.
Mon analyse :
- On touche là à la question de la visibilité de la maladie chronique (du moins de la mienne, mais je pense qu’en cela elle est proche d’autres maladies chroniques, comme le diabète).
- J’étais bien consciente du fait que contrairement à une personne en fauteuil roulant, ça ne se voyait pas que j’étais malade. Mais en même temps, comme j’allais tous les après-midi chez la gardienne pour prendre mes médicaments, je savais que mes camarades se doutait de quelque chose.
- C’est moi qui ai choisi ma maladie comme sujet. J’ai préféré devancer les choses que les subir. Pour moi, c’était une démarche assez naturelle. Logique (on verra que ça s’est compliqué à l’adolescence).
Maitre Garel était un très bon instituteur qui a accompagné et encouragé cette démarche.
En CM2, je vais en classe verte !
Les faits : le fait de devoir prendre des médicaments toutes les 6h (donc y compris la nuit) ne m’a pas empêché de partir une semaine en classe verte avec toute ma classe.
Mon analyse :
- Ma maladie n’a pas été source de handicap. Ce voyage organisé dans un cadre scolaire auquel j’ai pu participer a eu de grandes répercussions sur la socialisation que j’ai pu développer par la suite dans un cadre plus personnel.
- J’étais déjà partie en vacances en dehors du cercle familial grâce aux scouts. Arguments qui avaient sans doute joué en ma faveur au moment de convaincre l’école de m’emmener. Mais aux scouts c’étaient les cheftaines qui venaient me réveiller pour ma prise de médicament pendant la nuit (je devais dormir près de la porte de la tente, même quand je n’étais pas seconde ni sizenière !). Avec l’école il était impensable de demander au prof de se lever toute les nuits.
- Pour participer à ce voyage, il fallait que je sois capable de prendre mes médicaments toute seule la nuit. Avec mes parents on a mis en place un système : ils ne venaient plus me réveiller. Je mettais moi-même un réveil. Je prenais mes médicaments et je venais leur dire que c’était bon, qu’ils pouvaient éteindre leur propre réveil (qu’ils mettaient quand même par sécurité)… jusqu’à ce que je ne vienne plus les voir du tout et qu’ils puissent (enfin !) dormir tranquilles. La classe verte a été un super objectif pour me faire gagner en autonomie !
- Après cette expérience j’ai pu aller dormir chez des copines. Il fallait juste que ça soit organisé à l’avance pour que j’ai mes médicaments sur moi (je ne pouvais pas décider à la dernière minute de prolonger une soirée qui se passait bien par exemple, il fallait toujours que j’anticipe en ayant une ou deux doses d’avance sur moi).
- Rétrospectivement, je me dis que je dois beaucoup à M. Levko, mon professeur de CM1 et de CM2. Il m’a vraiment aidée à me construire une image positive de moi. Quand j’y repense, je me dis que je n’étais peut-être pas si douée en ultimate ou en escalade que ce qu’il laissait entendre… à moi mais aussi aux autres, qui avaient tendance à se moquer de la petite nouvelle que j’étais. Ma mère et son nouveau compagnon avaient déménagé durant les vacances entre le CE2 et le CM1 et je débarquais dans un établissement où au début on s’est effectivement moqué de ma petite taille.
En sixième, une nouvelle vie commence (crise d’ado et non observance) !
Les faits : Contrairement à mes camarades, je ne vais pas à Victor Hugo (le collège public de ma ville), mais à Blanche de Castille (un collège privé auquel je dois me rendre en bus).
Parce que Victor Hugo, contrairement à Blanche, ne dispose pas d’une infirmerie ouverte toute la journée, mais aussi parce que Blanche a un meilleur niveau. Et que, j’ai beau être malade, je suis toujours bonne élève. Je suis même particulièrement bonne élève, comme si j’avais déjà assez de problèmes comme ça et que je n’avais pas envie que la question des mauvaises notes vienne s’y ajouter.
Pour en avoir parlé avec elle, ma mère m’a dit qu’elle avait fait ce choix pour que je puisse compenser mes (éventuelles) limites physiques par une sorte d’excellence intellectuelle.
Toujours est-il que j’entre dans un lycée où je ne connais personne et où surtout personne ne me connaît.
Mon analyse :
- La question de la visibilité de la maladie s’est de nouveau posée : maintenant que les médicaments ne se gardent plus au froid je peux sans problème les prendre toute seule à la cantine, je n’ai pas beaucoup de rendez-vous médicaux donc mes absences ne me rendent pas suspecte… J’en ai conclu que tant que je ne disais rien, personne ne pouvait être au courant. Du coup je ne l’ai dit qu’à celles qui étaient devenues mes amies très proches, uniquement après que nous ayons véritablement fait connaissance. Je voulais d’abord qu’elles considèrent (et apprécient) la personne que j’étais. Et non qu’elles se sentent obligées d’être mes amies par pitié, parce que j’étais malade. A l’époque, j’ai dit à très peu de personne que j’étais malade (le nombre se compte sur les doigts d’une main). C’était un signe de confiance parce que je ne voulais pas que ça sache, de peur que le regard des autres sur moi change.
- Contrairement à l’enfance, l’adolescence est un âge où on accorde une importance incroyable au regard que les autres portent sur nous. Je ne le conscientisais sûrement pas à l’époque mais le regard que je posais sur moi était lié au regard que les autres posaient eux-mêmes sur moi. Je ne me demandais pas quel regard est-ce que j’acceptais qu’ils posent sur moi.
- Sans doute était-ce aussi par discrétion que je ne voulais pas annoncer à tout le monde que j’étais malade. Je ne voulais pas l’imposer à l’autre, sans me rendre compte que ce comportement signifiait que je ne lui faisais pas confiance dans sa capacité à m’accepter comme j’étais. C’est ainsi que j’interprète, a posteriori, la réaction d’un de mes amis quand je le lui ai dit alors que notre amitié durait déjà depuis 3 mois : incompréhension et colère.
Au collège, je voulais être comme les autres, et – compte tenu du peu de visibilité de ma maladie – je pensais que c’était possible. Je voulais pouvoir être insouciante comme eux, me poser les même questions futiles qu’eux. J’enviais la banalité de ce qu’ils vivaient alors que pour moi tout était toujours compliqué. Si la crise d’ado est une crise identitaire, moi je ne voulais plus être identifiée et m’identifier à ma maladie.
Si l’adolescence est marquée par des comportements à risque, mon comportement à risque à moi n’a pas été de fumer des joints ou de faire du scooter sans casque mais de ne pas prendre mes médicaments. A la fin du collège j’ai clairement été “non observante” : ce n’est plus moi mais les WC qui avalaient la grande majorité de mes médicaments !
Mon analyse :
- Au cours de mes années de collège je suis entrée dans un cercle vicieux : moins tu prends tes médicaments, plus ça va mal et plus ça va mal, plus on te prescrit de médicaments… que tu ne prends pas plus parce qu’ils rendraient ta maladie encore plus visible.
- La maladie chronique est particulièrement difficile à vivre à l’adolescence parce que le propre de la maladie chronique est de se développer sur le long terme alors que l’ado ne pense qu’à court terme. Ado, tu vis dans l’instant. Il n’y a que ça qui compte. Et qui compte terriblement. Tu n’as pas du tout envie de te projeter dans l’avenir. Or à court terme, tu vis mieux en ne prenant pas tes médicaments : tu peux dormir tranquille un nuit entière, tu n’as pas mal au ventre, tu n’as pas peur de puer de la gueule (effet secondaire !). Tu ne te rends pas compte que tu abimes ton avenir…
- Enfin, si, tu le sais mais tu n’arrives pas à faire autrement ! Tu n’en a pas la force. Au plus profond de moi je sentais bien que j’étais en train de partir en live et je ne rêvais que d’une chose : qu’un adulte me remonte les bretelles et viennent me sortir de là. Toute seule, j’en étais incapable. Il me semble que c’est typique de l’adolescence de ne pas pouvoir s’auto-infliger une contrainte mais en même temps de rechercher cette contrainte. Si elle vient d’un adulte, on va pouvoir la critiquer (y compris devant les autres) tout en étant conscient qu’elle est salutaire. Adolescent, c’est difficile de revendiquer sa liberté tout en reconnaissant qu’en l’absence totale de cadre on est perdu.
- Plus ou moins consciemment je pense aussi que quelque part j’ai vécu le fait que mes parents me laissent gérer seule mes médicaments non pas comme une prise d’autonomie mais comme un abandon de leur part. Mais formuler que je me sentais abandonnée, c’était reconnaitre que j’avais besoin d’aide. Et c’était contradictoire avec les envies de liberté et d’autonomie propre à l’adolescence.
- Quand ils se sont rendus compte que j’étais non observante, et qu’ils n’en croyaient pas leurs oreilles, j’avais envie de les mettre au défi non pas de les prendre mais déjà seulement d’y penser : 4 fois par jours, 365 jours par an !
A défaut de pouvoir les prendre pour lui, comment aider l’adolescent atteint de maladie chronique à prendre ses médicaments ?
Il me semble que l’ado a besoin d’un cadre spécifique, non seulement à la maison mais aussi à l’école. Si c’était à refaire, je pense qu’à cette époque, j’aurais mieux fait d’aller prendre mes médicaments à l’infirmerie plutôt que de (ne pas) les prendre à la cantine. L’infirmerie aurait pu être ce cadre qu’on m’imposait, en apparence malgré moi. Et du coup je n’aurais plus été seule, j’aurais embarqué l’infirmière avec moi. Ça l’aurait mouillée, elle aussi : si un jour je n’étais pas venu prendre mes médicaments, elle aurait dû venir me chercher. Rien que de savoir ça – cette potentialité – ça m’aurait peut-être suffit pour aller les prendre (toujours sur cette histoire de visibilité : aller prendre discrètement ses médicaments à l’infirmerie est une chose, venir se faire chercher par l’infirmière en plein cours en est une autre !).
Mais encore aurait-il fallu qu’elle accepte de prendre cette responsabilité, pas seulement pour quelques semaines mais sur des mois voire des années.
Stoppée en seconde par l’entrée en dialyse puis la transplantation.
Les faits : compte-tenu de la mal voire non observance de mes années de collège, je suis arrivée en phase d’insuffisance rénale terminale plus vite que prévu.
Mon analyse :
- J’ai été rattrapée par la visibilité de ma maladie. Non seulement, compte tenu de mon état de santé j’avais des rendez-vous médicaux beaucoup plus fréquents. Mais surtout mes rendez-vous préopératoires pour la mise en place de ma fistule artério-veineuse m’ont fait rater des “contrôles communs”.
- Pour mettre fin à la rumeur de tire au flanc (et qui plus est protégée !) qui commençait à courir sur mon compte, j’ai décidé de faire un nouvel exposé sur ma maladie. De toutes façons, avec les séances de dialyse une fois/semaine et le risque d’être appelée à tout moment pour la greffe je n’allais plus pouvoir le cacher (et encore, toujours pour des raisons de “visibilité” et d’étiquettage, je ne voulais pas qu’une ambulance vienne me chercher à la sortie de l’école pour m’y emmener. A la limite un taxi … Finalement ce sont mes parents qui ont fait les allers-retours).
- Contrairement à ce qui s’était passé en CP, j’ai un peu attendu le dernier moment. Je me rappelle avoir fait ça au début d’un cours d’éducation civique, en mettant un peu le professeur devant le fait accompli. Mais ce n’est pas seulement une volonté de ma part de ne pas en parler, c’est aussi que la nouvelle de la dialyse et de la greffe m’est tombée dessus sans crier gare. Un mois avant que le mot “dialyse” ne soit prononcé par le médecin j’en ignorais moi-même l’existence ! Et je ne pensais pas que la greffe pouvait s’appliquer à mon cas. Le problème d’une maladie rare, c’est qu’on ne s’est pas vraiment comment elle va évoluer. C’est parce que l’hôpital ne nous avait pas bien préparés à la suite des évènements, que mes parents et moi n’avons pas bien pu préparer l’école.
- Le fait d’avoir clarifié la situation auprès de mes camarades a effectivement simplifié ma situation. Par exemple, je n’ai pas eu besoin de me cacher pour mettre ma pommade anesthésiante les jours où je devais partir en dialyse. Et, de mémoire, je n’ai pas eu l’impression que mes camarades me prenaient en pitié (il faut dire que j’avais bien précisé que je ne voulais pas de ça dans mon exposé !) mais qu’ils se montraient compréhensifs et bienveillant. C’était agréable de ne plus être en lutte avec soi-même.
- Finalement j’ai été appelée pour la greffe pendant les vacances de Pâques. Mes parents l’ont annoncé à l’école, qui l’a annoncé à mes camarades. Suite à cette annonce (et aux complications liées à l’opération) il y a eu un grand mouvement d’émotion et de solidarité aussi bien du côté que de celui des profs. Les mots que j’ai reçu m’ont fait chaud au cœur et m’ont aidé à tenir le coup pendant mon hospitalisation.
Le difficile retour en première
Les faits : Greffée en mai, je ne suis retournée à l’école qu’en septembre. Comme j’étais bonne élève (et qu’il n’y a pas d’examen la fin de la seconde), j’ai pu passer en première même si j’avais raté tout le dernier trimestre de la seconde.
Mon analyse :
- Ce ne sont pas des problèmes “techniques” qui ont rendu mon retour en classe difficile. Les précautions à prendre dans les premiers mois après la greffe (telles que suivre un rigoureux régime sans sel et sans sucre, porter un masque sur le visage dans tous les lieux publics…) n’étaient plus d’actualité. Mais j’appréhendais de retourner à l’école après 4 mois d’absence durant lesquels mes camarades et moi n’avions clairement pas vécu la même chose.
- J’avais du mal à assumer ma nouvelle image. Avec mes joues grossies par la cortisone j’avais peur qu’on ne me reconnaisse pas.
- Mine de rien j’avais raté pas mal de cours. En français, la prof avait commencé à les entraîner pour le bac. Je me souviens très bien du premier DST de Français de mon année de 1ère, sur un sujet du bac. J’ai complétement paniqué. J’ai dû aller à l’infirmerie … et maman à du venir me chercher. Pour un retour à la vie normale ça commençait mal !
- Au-delà des cours, j’avais raté la vie de la classe. Pour moi, à l’hôpital, le temps s’était figé, alors que pour mes camarades il avait continué. Et à l’adolescence, il file particulièrement vite : les couples se font et se défont à vitesse grand V, la chanson à la monde la veille ne l’est plus le lendemain, tout comme les vêtements ou les blagues…. Il m’a fallu un peu de temps pour me remettre au goût du jour.
Passer le BAC en étant reconnue “handicapée”
Les faits : Après un examen à la MDPH, j’ai obtenu un tiers temps pour passer le bac
Mon analyse :
- Ça me faisait bizarre de pouvoir bénéficier d’un tiers temps alors que je n’avais pas de mauvaises notes. Mais une instance autre que mes propres médecins avaient reconnu que j’y avais droit. Ce n’était donc pas pour rien. Et après tout, c’est vrai qu’il y avait des effets secondaires des médicaments handicapants (ce n’est pas facile de colorier sans dépasser une carte de géographie ou de tracer avec précision des courbes dans un plan orthonormé quand tu trembles comme une grand-mère !).
- Mais surtout je me suis dit que ma maladie m’avait en effet pris beaucoup de temps dans ma vie (au-delà des rdv médicaux, elle m’avait beaucoup occupé l’esprit) et je voyais le tiers temps comme un dédommagement par rapport à ça. Ce temps que je n’avais pas pu consacrer aux études, je le rattrapais là. C’est la façon que j’avais trouvé de rendre acceptable pour moi cet étiquette de « personne handicapée ».
- Finalement j’ai eu mon BAC ES mention très bien. Je me souviens que j’ai même battu ma meilleure amie, pourtant 1ère de la classe… parce que j’avais eu 19 en philo. Sans doute pas anodin quand on sait que la maladie m’a forcéz à avoir un regard un peu distancié sur le monde…
Trois ans de classes préparatoires littéraires … et l’ENS par l’entrée des artistes
Les faits : après mon bac, j’ai fait une hypokhâgne et deux khâgnes (d’abord à Blomet puis à Lakanal). Après avoir été sous admissibles deux fois à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, je suis rentrée sur dossier à l’ENS d’Ulm.
Mon analyse :
- Au début, j’avais choisi la prépa littéraire pour la pluridisciplinarité que cette formation proposait. Je n’avais pas envie de me spécialiser tout de suite. Mais peut-être que c’était aussi un nouveau challenge. Je ne voulais pas qu’il puisse être dit (ou que je puisse croire) que ma maladie m’empêche de faire quelque chose.
- Comme tout le monde la prépa a été un moment difficile, mais peut-être un peu plus que pour d’autre parce que je partais avec un handicap, au sens des courses hippiques où l’arbitre décide du poids supplémentaire à placer sur le dos du cheval qu’il juge le plus rapide. Ma maladie a été un poids supplémentaire. Que je ne pouvais partager avec personne. Aucune de mes amies ne m’avais suivie dans mon choix d’une filière littéraire après un bac ES. Certes, je m’en suis refait sans difficulté (et par deux fois, puisque j’ai changé d’établissement pour cuber) mais je ne voulais pas les embêter avec mes problèmes, la prépa nous en créant déjà assez comme ça ! Et comme je devais absolument être en foyer pour m’éviter la fatigue des transports, je ne pouvais pas aller me réfugier dans les bras de mes parents ! Chose que je n’ai d’ailleurs jamais faite, ni avant ni après !
- Avec le recul, je suis contente de ne pas avoir eu l’ENS ! Et oui, pas de super “happy end” où j’aurai réussi malgré tout. Non, j’ai échoué au concours… comme beaucoup d’autres ! J’ai beau être malade, je ne suis pas superpuissante. Ma maladie ne m’empêche pas d’essayer de faire de grandes choses, mais elle ne me permet pas pour autant de les réussir !
- Dans ma construction personnelle, le fait d’être entrée sur dossier à l’ENS m’a beaucoup apporté. Sans doute plus que si j’étais rentrée sur concours. Pour l’oral, il fallait que je choisisse un sujet de recherche – et ce en très peu de temps (entre la parution des noms des candidats retenu et le jour de l’examen) – alors que depuis trois ans j’avais beaucoup appris sans plus trop me demander ce que j’aimais apprendre ! Du coup, j’ai fait simple. Je me suis dit que le théâtre m’intéressait et que la question de la différence, radicalisée dans ce qu’on appelle “le handicap”, aussi. Et que j’allais tenter de voir ce que cela pourrait donner de croiser les deux. J’ai proposé aux membres du jury de travailler sur “théâtre et handicap”, un sujet qui a plu ! Et que j’ai “décliné” pour mes deux masters (en Master 1 j’ai travaillé sur le handicap dans le théâtre de Pippo Delbono et en Master j’ai étudié le travail de Philippe Adrien avec la Compagnie du Troisième Œil) et pour maintenant pour ma thèse.
- Ce n’est qu’aujourd’hui que je me rends vraiment compte que mon sujet de doctorat, “original” dans le champ de la recherche, est surtout très poche de moi. En travaillant sur “Présence et représentation du handicap mental sur la scène contemporaine française”, j’aborde dans un cadre distancié et formel, des problématiques qui me sont familières. Ce n’est par exemple pas un hasard si je fais une grande place au concept de visibilité. Une autre personne aurait sans doute abordé les choses autrement. Moi, ça me parle (et m’intéresse) particulièrement !
- Ainsi, la scolarité n’est pas une fin en soi, c’est un chemin qui conduit à la vie active. Et finalement je trouve que la place que j’occupe aujourd’hui est cohérence avec le parcours que j’ai suivi. C’est parce que j’ai choisi un sujet proche de moi et de mes préoccupations que je peux m’épanouir.
… Et le théâtre dans tout ça ?
Quand j’y réfléchi, le vrai fil rouge de ma scolarité, c’est le théâtre. C’est ce que j’ai fait du CP à maintenant, sans interruption.
Pour moi, les ateliers théâtres auxquels j’ai participé n’ont pas seulement été une quelconque activité de sociabilisation mais des expériences humaine particulièrement riches. J’ai rencontré des gens vers qui je ne serais pas allée spontanément dans la vie courante. Dans les troupes dont j’ai fait partie, j’ai toujours trouvé ça beau de voir comment nous unissions nos efforts et nos particularités au service d’un beau projet commun.
Chacun des membres y mettait du sien pour monter un spectacle qui tient la route pour la fin de l’année. Les différences étaient mises de côté – voire étaient intégrées – au profit de ce but commun.
Et puis, faire du théâtre m’a permis de me confronter à mon image. Je me souviens que ça n’a pas été évident pour moi de remonter sur scène après la greffe, de présenter aux spectateurs mon nouveau visage, un visage modifié par les médicaments. En fait, c’est mon amour du théâtre qui m’a pour ainsi dire obliger à m’assumer. Et cette pratique du théâtre s’est finalement révélée extrêmement valorisante pour moi.
Aujourd’hui, si je fais une thèse sur “présence et représentation du handicap mental sur la scène contemporaine française” et que je monte une pièce comme HOSTO c’est bien parce que je pense que le théâtre peut non seulement aider la société la changer le regard qu’elle porte sur les personnes dites “en situation de handicap”, mais qu’il peut aussi aider ces personnes à changer leur regard sur elles-mêmes.
Peut-être que ce que j’ai trouvé dans un cadre extra-scolaire devrait être véritablement inscrit dans le cadre scolaire. D’une part, je pense que les écoliers, collégiens, lycéens, étudiants devraient assister à des représentation théâtrales leur fasse voir le handicap, c’est-à-dire qui le leur rendre visible, mais que le leur fasse voir autrement, c’est-à-dire non pas comme un manque mais comme une potentialité artistique et une richesse sociale.
D’autre part, je pense que les écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, en situation de handicap ou non devraient participer ensemble à des ateliers de théâtre, parce que c’est là qu’on se découvre autrement, et qu’on peut tenter d’expérimenter d’autres formes du vivre ensemble.
Maladie chronique et scolarité : l’importance d’être soi-même
L’expérience de la maladie chronique m’a finalement peut-être fait prendre conscience d’une façon particulièrement accrue de l’importance d’être soi-même.
Puisqu’il est la conséquence (notamment sociale) d’une déficience ou d’une pathologie, le handicap n’existe pas en soi.
Il n’existe que des situations de handicap. Et pour que celles-ci puissent être évitées, il faut faire des efforts des deux côtés.
Que chacun soit dans la sincérité par rapport à l’autre, mais peut-être aussi – et surtout – par rapport à lui-même.
> Retrouvez la Compagnie en carton, compagnie de théâtre créée par Marie
> Et aussi sur Facebook













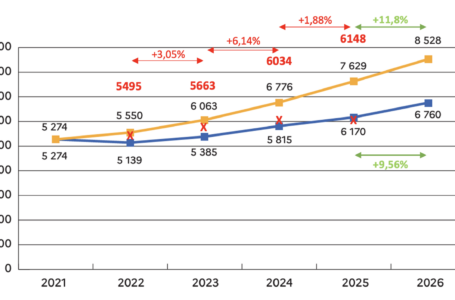









 Followers
Followers
4 Commentaires
Bonjour Marie,
Je me reconnais totalement dans vos descriptions qui sont d’une réelle justesse. Je pense que dans le dispositif actuel de prise en charge purement médical de la maladie chronique a l’adolescence, un soutien, voire un ancrage psychologique en dehors des figures autoritaires toujours mises en péril a cet age devrait etre obligatoire. Une forme d’accompagnement, de tutorat, venant de l’éducation spécialisé ou de la psychologie dans les deux cas par des personnes sensibilisée a la fois par le monde adolescent et la maladie chronique. Merci de votre témoignage dans lequel je pense nombre de jeunes malades peuvent se reconnaitre, moi en premiere ligne. Amicalement, erwan.
Ca ne correspond pas à mon vécu en tout cas.
Cette omniprésence d’être malade voir différent, je ne l’ai jamais senti.
En fait, vu qu’il s’agit d’une maladie qui à plusieurs traitements alternatifs, pour moi elle n’a aucune criticité et donc pas “d’épée de Damoclès” comme beaucoup le ressente.
Je verrais bien plus cette épée de Damoclès si j’attendais un coeur ou un poumon par exemple.
Bref je penses à ma vie, mes projets. Bien sûr je fais plus attention mais ça s’arrête là.
J’ai vécu comme mes camarades, j’ai fais le sport comme les autres, et je n’ai pas de revanche sur la vie non plus.
Je n’ai jamais fait de démarches concernant le handicap ou autres.
Et le théâtre ? Non merci ! ^^
Je sais qu’il va y avoir des épreuves à l’avenir mais quand et lesquels ?
Personne ne le sait donc on verra bien sur le moment.
Et finalement ces épreuves peuvent être de tout ordre: familial, professionnel, santé…
Voila comment je le vis.
Bonjour je comprends complètement, je suis photographe et aimerais faire un livre sur la maladie chronique invisible! Etant greffée avec un traitement bien fatiguant, ne reste qu’à trouver le temps!
Bonjour,
J’ai 33 ans et je suis atteinte de cette maladie. Tous les détails et esplique ce qu’elle esplique dans la vie. Je comprends toute a fais car je l’ai vécu moi même..
J’aimerai prendre contacte avec Marie afin d’échanger nos vécus..
Bonne journée
Amandine