Dons d’organes: pénurie ou incurie ?
6 janvier 2005, Reader’s Digest Québec
Pourquoi tant de patients meurent-ils en attente d’une greffe alors que des solutions simples existent ?
Père de deux enfants atteints de fibrose kystique, Denis Mouton, de Longueuil, est conscient de l’urgence absolue qu’il y a à réformer le système des dons d’organes. “Ma fille Valérie aura 25 ans dans quelques jours et sa vie est en sursis, écrivait-il à Jean Charest en octobre dernier. Seule une transplantation lui permettra de “souffler” ses 26 bougies.”
Sa lettre devient par endroits un réquisitoire contre les lacunes et la cruauté du système actuel. Dans certains cas écrit-il, ” être sur une liste d’attente revient à “attendre” la mort… dans un espoir vain et infernal “. La faute en est en partie due à l’absence d’un registre de consentement (dont nous parlions dans notre numéro du mois dernier – Dons d’organes: pénurie ou incurie?) et au caractère totalement facultatif de la carte de donneur. Nombreux sont en effet les donneurs potentiels qui, par négligence ou par distraction, ne collent jamais sur leur carte d’assurance maladie le fameux petit collant de consentement.
Pour remédier à cela, continue Denis Mouton, il suffirait de rendre obligatoire la carte de donneur. Pour obtenir sa nouvelle carte soleil, tout citoyen recevant son formulaire de renouvellement serait tenu de répondre “oui” ou “non” à la question: Accepteriez-vous de donner vos organes après votre mort? Toute acceptation de sa part devrait également être signée par un témoin (un proche, de préférence) qui pourrait être directement contacté en cas de décès du donneur. “Ce choix (OUI ou NON) serait imprimé sur la carte d’assurance maladie et répertorié dans un registre permettant un accès rapide et efficace des données par les autorités médicales.”
Roxanne, 12 ans, ressent ses premières douleurs à l’estomac au début de l’hiver 1998. “Mais elle ne se plaignait jamais et adorait la vie. Elle avait toujours été en excellente santé et adorait jouer avec ses copines et avec Nathalie, sa sœur aînée”, raconte Yvon Saint-Denis, qui élève seul ses filles.
Quelques jours plus tard, les douleurs ne se dissipant pas, Yvon la conduit aux urgences. Les résultats de la radiographie des poumons sont assez préoccupants pour que l’adolescente soit immédiatement transférée à l’Hôpital de Montréal pour enfants, où une biopsie révèle une pneumopathie interstitielle. Cette maladie rare des poumons se caractérise par un épaississement des tissus pulmonaires qui finit invariablement par tuer le patient. Seule une transplantation pulmonaire peut sauver Roxanne.
Reste à trouver un donneur.
Yvon, préposé à l’entretien à l’Hôpital général de Montréal, alerte les médias : radio, télévision, magazines, journaux. “Tout le monde devait savoir que Roxanne avait besoin de poumons”, dit-il. Un an plus tard, Yvon s’aperçoit que Nathalie, sa fille de 14 ans, est souvent fatiguée après avoir joué dehors avec ses amies. A l’hôpital, il apprend, horrifié, qu’elle souffre du même mal que sa sœur. “Personne n’arrivait à croire que le malheur puisse s’acharner sur nous à ce point!”
Le 31 janvier 2000, 10 jours avant son 14e anniversaire, Roxanne perd la bataille: ses poumons trop scarifiés n’arrivent plus à fournir de l’oxygène à son sang. Elle attendait un don d’organes depuis plus d’un an. En mai 2001, Nathalie succombe à son tour. Son nom est resté sur une liste d’attente pendant sept mois. Yvon Saint-Denis est inconsolable. “Le gouvernement ne sensibilise pas assez le public, souligne-t-il. Les responsables devraient inciter la population à signer l’autorisation de prélèvements d’organes.”
Vies brisées
La mort tragique d’un enfant fait toujours la une des journaux. Mais des centaines de personnes meurent au Canada simplement parce que le système de don d’organes ne fonctionne pas aussi bien qu’il le devrait. Au Québec, seulement 17 personnes par million d’habitants ont donné un organe après leur mort. C’est mieux que dans le reste du Canada, où ce taux est de 13 par million, mais c’est tout de même l’un des plus faibles de toutes les nations industrialisées. Au cours des 10 dernières années, le nombre de Canadiens en attente de greffe d’organe a presque doublé. En 2002, 237 patients sont morts – chiffre officiel – dans l’attente d’une transplantation. Mais il ne s’agit là que des malades dont les noms se trouvaient sur une liste d’attente. Présentement, quelque 4000 patients y sont inscrits (environ 900 au Québec).
“En raison de la pénurie de dons qui frappe le Québec depuis une dizaine d’années, nous ne pouvons pratiquer que 35 transplantations par an, alors qu’il faudrait en faire 200, explique le Dr Renzo Cecere, directeur chirurgical du programme d’insuffisance cardiaque et de transplantation thoracique du Centre universitaire de santé McGill à Montréal. Environ le tiers des malades restants mourront malheureusement avant.”
La pénurie d’organes est d’autant plus regrettable que les greffes connaissent un taux de réussite très élevé. “Tous les professionnels de la santé éprouvent à ce sujet un énorme sentiment de frustration : ils ont le pouvoir de sauver des vies, mais ne peuvent le faire faute d’organes, dit le Dr Eugene Bereza, directeur du programme d’éthique médicale du Centre universitaire de santé McGill. C’est une tragédie.”
Même si les percées médicales et des mesures plus efficaces en matière de sécurité routière réduisent le nombre de décès, cette pénurie n’est pas due à la rareté des donneurs potentiels, mais à l’obligation de consulter la famille avant tout prélèvement. Or, si les familles de patients décédés ne donnent pas, ce n’est pas par mauvaise volonté, mais tout simplement parce qu’on ne le leur a pas demandé.
Mourir sous dialyse
Installée dans un fauteuil à l’hôpital, une aiguille dans le bras la reliant au dialyseur, Francesca Avvenire, 42 ans, regarde fixement le mur de la pièce. Depuis que ses reins ne fonctionnent plus, l’hôpital est devenu sa seconde résidence. Tous les deux jours, pendant quatre heures, le dialyseur est sa ligne de vie. Mais elle a l’impression d’en être la prisonnière. Francesca ne peut pas partir en vacances, ni manger ce qu’elle aime, ni boire jusqu’à plus soif, ni exercer un métier.
Depuis plus de trois ans, elle attend un appel téléphonique lui demandant de se précipiter à l’hôpital pour une transplantation. Deux de ses meilleurs amis, qui étaient aussi en dialyse, sont morts. “Ce n’est pas une vie, dit-elle souvent à son mari et à sa famille. Tout n’est que restrictions dans mon existence, et je suis trop épuisée pour faire quoi que ce soit.” Fatiguée, découragée, elle déprime. Sa famille et ses amis sont inquiets.
Début 2003, dans un geste de générosité, sa mère, son frère, sa sœur, ses cousines, et même leur pasteur, subissent les tests de compatibilité pour lui donner un rein.
“Sammy, mon frère cadet, était tout à fait compatible.”
La transplantation réussit. Francesca se sent à nouveau pleine d’énergie. Elle peut enfin sortir, se distraire.
“Je me sens merveilleusement bien! Sammy m’a rendu la vie!”
Il y a des jours où Francesca s’interroge sur le prix payé par son frère:
“Il s’est bien remis, mais j’aurais préféré recevoir un rein d’un donneur décédé. Sammy n’aurait pas dû traverser cette épreuve.”
Une étude du comité de transplantation du Collège des médecins du Québec, parue en 2003, révèle qu’en l’an 2000, au Québec, environ le tiers des familles de donneurs n’ont pas été consultées. Il y a plusieurs explications à cela, observe le Dr Réal Cloutier, qui a dirigé l’étude : ” Certains médecins ne font face à cette situation qu’une fois par an et n’ont pas le réflexe de penser au don d’organes lorsqu’ils ont un patient en état de mort cérébrale. D’autres sont mal informés en matière prélèvements, ou mal à l’aise dès qu’il s’agit d’aborder les familles pour demander un don.”
Par ailleurs, certains hôpitaux manquent de lits dans les services de soins intensifs. “Le médecin se trouve parfois devant un choix difficile: mobiliser un lit pour maintenir artificiellement en vie un patient en état de mort cérébrale, ou l’affecter à un autre patient dont l’état est très critique, mais qui a une chance de survivre”, explique le Dr Cloutier.
Un sondage Léger Marketing, réalisé en 2002, indique que plus de trois Québécois sur quatre se disent prêts à offrir leurs organes à leur décès. Pourtant, 53 pour 100 seulement ont pris des dispositions soit en avisant leur famille, soit en signant l’autocollant de donneur d’organes qui doit être apposé au verso de la carte d’assurance maladie (38 pour 100).
“Rares sont ceux qui savent comment devenir donneur d’organes”, explique Liz Anne Gillham-Eisen, de Santé Canada. “Nous savons cependant que, lorsqu’on les sollicite, la plupart des Canadiens acceptent de donner, note le Dr Philip Belitsky, directeur d’un service de transplantation en Nouvelle-Ecosse. C’est pourquoi il est important d’informer le public et de faire en sorte que les hôpitaux puissent identifier les donneurs potentiels et aborder ensuite leur famille.”
Pour faire face au besoin désespéré d’organes, les chirurgiens ont recours à d’autres solutions. Environ 25 pour 100 des patients du Dr Isabelle Houde, néphrologue à l’Hôtel-Dieu de Québec, reçoivent un rein d’un donneur vivant – parent, conjoint, ami proche… Il s’agit là d’un dernier recours.
Cette technique va à l’encontre d’un principe fondamental de la médecine: ne pas infliger de souffrances inutiles. Mais Isabelle Houde sait que, pour les patients victimes d’insuffisance rénale, l’autre possibilité consiste en des années de dialyse, et donc en une perte considérable de la qualité de vie. On a aussi de plus en plus souvent recours à un donneur plus âgé, pour la greffe d’un rein, d’un cœur ou d’un foie (l’âge du donneur constituait jusqu’ici un puissant facteur dissuasif).
Un modèle de… désorganisation
La pénurie d’organes est encore aggravée par l’absence d’un système de répartition national. Chaque province dispose d’un registre de patients en attente, mais n’a pas accès à celui de ses voisines. Si le rein d’un donneur de groupe sanguin O positif est disponible en Alberta et qu’aucun receveur ne correspond à ce profil dans cette province, c’est cette dernière qui devra faire des démarches pour voir si ses voisines ont besoin d’un tel organe. Les provinces le font-elles? On peut se le demander quand on sait que le coût moyen pour assurer la prise en charge d’un donneur en état de mort cérébrale et pour prélever ses organes est de 17 000$!
En 1999, le Comité permanent sur la santé du gouvernement fédéral s’est penché sur l’amélioration du système de transplantations, et donc sur la possibilité d’établir un registre national de donneurs et de receveurs. Trouvant l’idée intéressante, le Comité a recommandé la formation d’un conseil national chargé de chercher des moyens d’augmenter le nombre de dons d’organes. En août 2001, le Conseil canadien pour le don et la transplantation (CCDT) a vu le jour. L’organisme entend faire du Canada un des leaders mondiaux en matière de don de tissus et d’organes.
En attendant, chaque province a sa propre législation, et les échanges interprovinciaux s’appuient sur des accords non officiels. “Une structure nationale accroîtrait considérablement notre efficacité”, affirme le Dr Bereza, qui ajoute que l’Association médicale canadienne soutiendrait le concept d’un registre national. A l’heure actuelle, seuls l’Ontario, la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Ecosse tiennent un registre des donneurs qui permet, à la mort d’une personne, de savoir immédiatement si elle a de son vivant autorisé les prélèvements d’organes. Et dans les autres provinces ? On s’adresse à la famille du patient en espérant qu’il aura fait part à ses proches de son intention de donner…
Révolution à l’espagnole
Ce qu’il convient de faire
Si une seule personne aujourd’hui donnait les organes d’un parent décédé, huit patients en danger de mort auraient une chance de survie (et 30 survivraient grâce à un don de tissus). Signez et portez sur vous une carte de donneur de tissus et d’organes. Plus important encore, discutez de votre volonté de donner des organes et des tissus avec des membres de votre proche famille, afin qu’ils soient informés de votre décision.
“Pourquoi ne pas améliorer une vie en laissant un peu de soi-même?” dit le Dr Réal Cloutier, secrétaire du comité de transplantation du Collège des médecins du Québec.
Les canadiens pourraient s’inspirer de l’Espagne, où l’Organisation nationale de transplantations, instaurée en 1989 et basée à Madrid, est le service de transplantation le plus efficace du monde. Comme dans de nombreux pays européens, les hôpitaux espagnols fonctionnent selon le principe du “consentement présumé”, ce qui signifie que les autorités médicales prennent contact avec la famille d’une personne décédée en présumant que celle-ci avait de son vivant accepté de donner ses organes; si, toutefois, elle avait refusé de le faire, c’est à sa famille d’en aviser les autorités.
Dans le système canadien, où les organes d’une personne décédée ne sont utilisés que si cette dernière a donné son consentement, la décision appartient à la famille. “L’application du “consentement présumé” augmenterait non seulement de façon substantielle la banque d’organes et de tissus, mais elle protégerait les droits des donneurs après leur mort – à condition qu’ils aient pris des dispositions pour bien faire connaître leurs intentions”, explique le Dr Fady Moustarah, chirurgien de Welland, en Ontario, et grand défenseur de ce principe.
“Les Canadiens semblent ouverts à l’idée”, indique le docteur Heather Ross, directrice médicale du programme de transplantation cardiaque à l’Hôpital général de Toronto, qui coprésidait en 2001 une consultation publique au cours de laquelle on demandait aux Canadiens leur avis sur les manières d’augmenter les dons d’organes.
Le système espagnol s’attaque aussi aux résistances qui se manifestent au sein de l’hôpital. Les coordonnateurs sont des médecins attachés à des services de soins intensifs. Ils identifient les donneurs et assurent la liaison avec les familles endeuillées. “Pour le médecin, il est bien plus facile de décider que le patient décédé ne fera pas un bon donneur, souligne le Pr Rafael Matesanz, artisan de la réforme espagnole. Cela lui permet d’éviter une procédure longue et compliquée.” Pour éviter ce piège, le système espagnol tient les coordonnateurs responsables s’ils essuient un nombre élevé de refus.
Le Québec commence à suivre. En 1999, le Centre universitaire de santé McGill a engagé une infirmière pour instruire le personnel médical au sujet du don d’organes et pour lui apprendre à aborder les familles dans le but d’obtenir leur consentement. Résultat: le nombre de dons d’organes a triplé en une année. A la suite de ce succès, le ministère de la Santé et des Services sociaux a affecté des infirmières de ce type à une vingtaine de centres hospitaliers.
Mais qu’en est-il des autres hôpitaux? Et comment s’assure-t-on que chaque patient souffrant d’une grave lésion cérébrale est adressé à une unité de soins intensifs capable de le maintenir en vie? “Ce travail ne doit pas être considéré comme une corvée par l’établissement, indique le Dr Bereza. Les médecins ne doivent pas oublier que le but est de sauver cinq, six, voire sept vies.”
Certes, le processus coûte cher, mais l’exemple espagnol est inspirant. “Depuis les changements apportés, nous avons fait 6400 greffes de rein supplémentaires, observe le Pr Matesanz. Les sommes économisées par l’abandon des dialyses sont plus élevées que le coût total du programme de transplantation espagnol.”
Au Québec, une greffe de rein coûte environ 20 000 $. Il faut ensuite compter 6000 $ par année pour les médicaments antirejet. Les coûts associés à la dialyse s’élèvent à environ 50 000 $ par année.
Un don de vie
Le 20 janvier 2001, Michel Lamarre, 43 ans, chef magasinier à Mascouche, est foudroyé par une attaque cérébrale. A l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, les médecins arrivent à arrêter l’hémorragie, mais la santé du malade décline au point que, deux jours plus tard, Michel est déclaré en état de mort cérébrale. Sa femme, Josée Bilodeau, respecte sa volonté de faire don de ses organes. En 1994, après une attente
de trois ans, Michel avait reçu un rein d’un donneur décédé. Il connaissait l’importance du don d’organes.
“Même si son cœur battait encore et qu’il semblait dormir, il n’était plus avec nous”, raconte Josée. Peu après, les membres de l’équipe de transplantation informent celle-ci de la procédure à suivre. Il est important que les proches puissent, d’abord, faire leurs adieux à celui ou à celle qui va les quitter. “Michel avait l’air serein, confie-t-elle. J’étais soulagée de voir qu’il ne souffrait plus.”
Quelques semaines plus tard, Josée apprend par une lettre de Québec-Transplant que les médecins de l’hôpital ont prélevé les deux poumons, les tissus de la peau et des os de son conjoint décédé. “J’étais tellement fière de lui! Lui qui avait reçu un don de vie sept ans plus tôt, il avait rendu la pareille à d’autres patients en attente.”










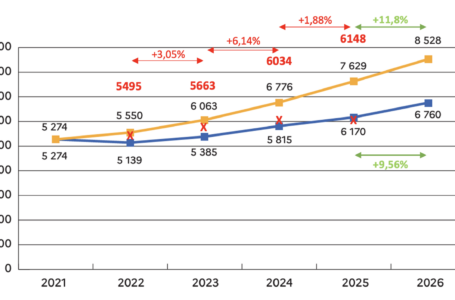









 Followers
Followers