Les corps après la mort : débat autour du don d’organe
19 mai 2003, Le Monde
Le scandale provoqué par la découverte, en Grande-Bretagne, que des prélèvements de cerveaux humains ont, durant les trente dernières années, été effectués dans des conditions illégales (Le Monde du 13 mai) est riche d’enseignements. Il témoigne d’une évolution notable, sans doute irréversible, de l’opinion quant à ce que le corps médical peut ou non être autorisé à faire sur le corps des personnes décédées. Il rappelle les difficultés croissantes auxquelles sont confrontées les équipes médicales spécialisées dans le prélèvement et la greffe d’organes à des fins thérapeutiques.
Enfin, l’affaire démontre l’urgence qu’il y a, en Grande-Bretagne comme ailleurs – et notamment en France -, à forger un nouveau cadre législatif qui permettrait de concilier plusieurs nécessités : le respect dû au corps humain après la mort, l’expression de la volonté individuelle ainsi que les progrès de la médecine et de la biologie.
L’un des aspects les plus étonnants de l’histoire réside dans un paradoxe : si la loi de 1961 sur les prélèvements d’organes (Human Tissue Act) interdit toute ablation sans le consentement explicite des proches du défunt, elle ne prévoit pas de sanctionner les praticiens qui ne respecteraient pas cette disposition… Sans doute peut-on voir là l’une des formes du pragmatisme britannique et une manière, certes quelque peu discutable, de ne pas s’opposer en définitive aux progrès scientifiques.
Mais ce qui pouvait être tacitement toléré il y a quarante ans est aujourd’hui devenu proprement intolérable. L’évolution des perceptions dans ce domaine résulte, entre autres, du développement considérable – grâce aux progrès conjoints de la réanimation, de la chirurgie et de la pharmacologie immunosuppressive – de la pratique des greffes d’organes.
Après une période où elles furent saluées comme un exploit spectaculaire de la médecine moderne (que l’on se souvienne de l’aura de Chris Barnard, auteur, en 1967, de la première transplantation de cœur), ces greffes, en se multipliant, devaient rapidement se banaliser. L’élargissement des indications et, corollaire, du nombre des malades en attente de l’intervention salvatrice conduisit, dans de nombreux pays industrialisés, à une demande sans cesse croissante d’organes. Le paradoxe voulut que cette évolution se produisît à une époque marquée, sinon par une véritable contestation contre le “pouvoir médical”, du moins par une adhésion de moins en moins forte à l’idéologie triomphaliste d’une médecine “toute-puissante”.
C’est dans ce contexte qu’éclatèrent en France, au début des années 1990, plusieurs affaires dans lesquelles des médecins furent accusés, comme aujourd’hui en Grande-Bretagne, d’avoir ” volé” des organes post mortem. En France, il y eut notamment en 1992 le grand retentissement de l’ “affaire d’Amiens” après la découverte, par les parents d’un adolescent décédé après un accident de la circulation, qu’une équipe du CHU de cette ville avait prélevé les yeux de leur fils. Cela, alors même que – tout en n’étant nullement opposés au principe même du prélèvement – les parents assuraient avoir explicitement demandé que l’on ne procédât pas à cette amputation.
Il y avait eu aussi, peu de temps auparavant, la découverte à Nantes que des têtes de cadavres avaient été utilisées, dans le cadre d’une instruction judiciaire, à des fins de recherches balistiques. Il y eut encore les réactions indignées de ceux qui apprirent que des cadavres humains pouvaient servir à améliorer la sécurité des habitacles automobiles.
LES DIFFÉRENTS USAGES
Bien qu’étant de nature fondamentalement différentes, toutes ces affaires avaient en commun l’utilisation, par le corps médical, de cadavres humains dans des conditions finalement considérées comme inacceptables. Elles eurent, de ce fait, un impact très négatif sur la pratique des prélèvements d’organes, aucun effort de pédagogie n’ayant été entrepris pour tenter d’expliquer les différents usages (à visée médico- légale, scientifique ou thérapeutique) qui peuvent être faits du corps humain après la mort.
Initialement encadrée par la loi Caillavet de 1976 puis par les lois de bioéthique de 1994, la pratique du prélèvement d’organes à des fins thérapeutiques a toujours, en France, été fondée sur un malentendu. La loi Caillavet repose sur le principe du consentement présumé : ne pas s’opposer explicitement, de son vivant, au prélèvement post mortem autorise, de facto, ce prélèvement. Mais, dans la pratique, les équipes médicales demandaient, de manière quasi systématique, l’accord de la famille – ne serait-ce que pour savoir si le défunt avait de son vivant exprimé ou non une opinion. Sans remettre en cause ce principe, les lois de 1994 ont prévu de faciliter l’expression du refus en créant un registre national automatisé, ce refus pouvant être révoqué à tout moment.
Pour autant, les médecins doivent toujours, en l’absence d’un refus clairement exprimé, obtenir l’accord de la famille. Le projet de révision des lois de bioéthique de 1994 – dont l’examen en seconde lecture par l’Assemblée nationale vient d’être repoussé sine die – ne comporte, sur ce point aucun changement. Sauf un : la possibilité de passer outre la volonté de la famille, dès lors que – référence à la forme humaine de la maladie de la vache folle – des impératifs de santé publique imposeraient la pratique de l’autopsie afin d’établir les causes exactes du décès.
Une telle situation est d’un point de vue sanitaire doublement pénalisante. Elle constitue tout d’abord un frein majeur au développement des greffes d’organes et condamne de ce fait à une mort programmée des personnes en attente d’une greffe. Elle conduit, d’autre part, à la quasi-disparition de la pratique de l’autopsie scientifique, pratique essentielle à la formation des praticiens et aux progrès de la médecine. La situation est d’autant plus paradoxale que, cinq ans après la création du registre national du registre des refus, seules 55 000 personnes ont manifesté leur opposition à toute forme de prélèvement post mortem.
Le moment, dès lors, semble venu d’entendre les arguments de ceux qui, comme le professeur Claude Got, spécialiste d’anatomo-pathologie et de santé publique, plaident pour un dispositif qui imposerait à chaque citoyen de formuler, de son vivant, une acceptation ou un refus. C’est un choix qui, via les technologies de l’informatique, pourrait être modifié à tout moment.
Sans doute ne sera-t-il pas simple d’expliquer les raisons qui conduisent notre société à devoir demander systématiquement à chacun son avis, favorable ou défavorable, sur les différents usages qui peuvent être faits de son corps après sa mort. Pour autant, seule une telle entreprise permettra, démocratiquement, de respecter les choix individuels sans pour autant s’opposer aux développements de la connaissance et aux progrès que la médecine moderne parvient à accomplir en inventant de nouvelles formes, biologiques, de solidarité et de fraternité.
Jean-Yves Nau










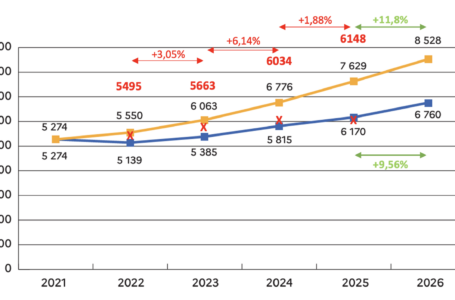









 Followers
Followers